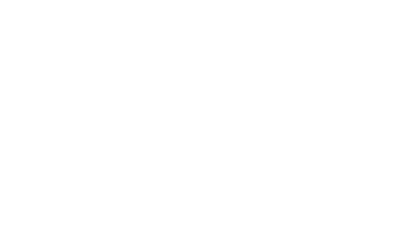Le Château de Serres

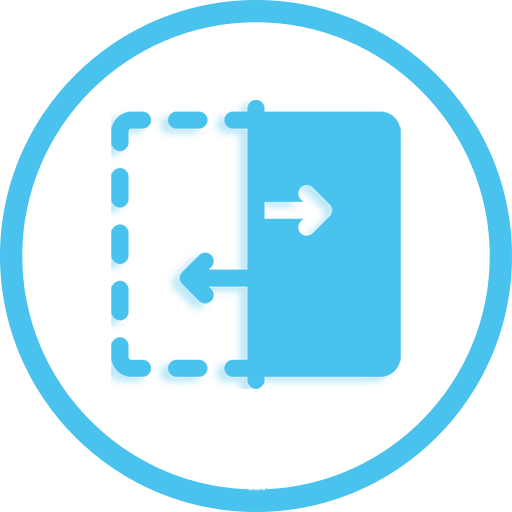



Le village de Serres apparaît pour la première fois demanière certaine dans les textes en 988, dans le testament du clerc Richaud. Cedernier octroie à l’abbaye de Cluny d’importants revenus, et mentionne l’existenced’un château à Cerredum (Serres). Il s’agitpeut-être d’une simple fortification sur le rocher de la Pignolette. Nous nesavons que très peu de choses sur cet édifice et nous ne pouvons que présagerla présence d’un donjon.
Au cours des siècles suivants, les fortifications sontagrandies pour devenir un véritable château fort prolongé par une muraille,dominant et protégeant le bourg, l’église et les différents accès. Sur la faceNord, la falaise assurait une protection naturelle. Dès la fin du XIIIesiècle, le château et la ville disposait sans doute d’un système défensif à peuprès complet. Il ne reste malheureusement pratiquement plus aucun témoignage decet état du château, largement remanié par la suite.
Lorsque Serres devient le chef-lieu du baillage du Dauphinévers 1340, le dauphin Humbert II confie à un architecte italien, AsturgoneMassipi, différents travaux dont l’agrandissement du château. Ces travaux seconcrétisent par la construction d’un important ouvrage défensif à l’ouest dudonjon existant. Le château est également amélioré au cours des périodessuivantes, avec la construction d’un colombier et d’une écurie en 1458, puis decanaux alimentant la citerne en 1484. Il est surtout doté de renfortsbastionnés pendant les guerres de religions. La seule représentation à peu prèscomplète de l’édifice dans sa plus grande extension est réalisée par Jean deBeins en 1609. Cette gravure montre l’aspect composite de l’ouvrage peu avantsa destruction.
Le château fait effectivement les frais de la politique deneutralisation des forteresses intérieures de la monarchie absolue. En 1633, lecardinal de Richelieu ordonne sa démolition. Le donjon constitué de matériauxtrop résistants sera détruit par la mine. L’opération de démolition de la forteresse,ainsi que la vente de ses débris sont attribués aux enchères. Les pierres sontréutilisées pour la construction du mur de soutènement sur la rive droite duBuëch.
Aujourd’hui, rien de l’édifice ne subsiste, si cen’est quelques vestiges enfouis.