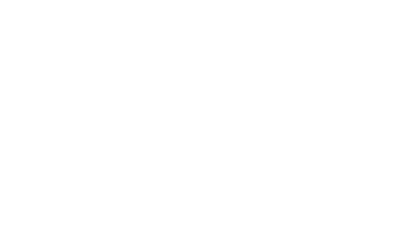Les terrasses

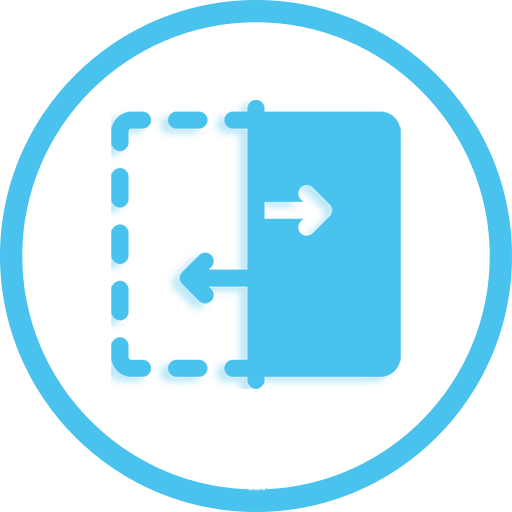



Le principal secteur des «Terrasses de Réallon » se situe à l’entrée du chef-lieu, sur les deux rives du cône de déjection du ravin Maou-Riou ; une originalité dans les Hautes Alpes liée à leur nombre et leur importance. Ces terrasses, vues de loin, soulignent les courbes de niveau de la pente.
Le GR50 sert de chemin de traverse ; il est bâti en palier (mur en amont et mur en aval) et assure une desserte horizontale est-ouest.
Les terrasses sont le schéma le plus abouti de la nature façonnée par l’homme. Cette expression du savoir-faire des hommes résulte d’un travail collectif qui ne se limitait pas à la famille. Le parcellaire des terrasses est très découpé, celui de la rive gauche mieux organisé.
Les délimitations sont assurées par des murets horizontaux et de nombreux clapiers. Le passage d’une terrasse à l’autre se fait par un système de rampes.
Chaque muret est au service du terrain qu’il soutient et s’adapte à sa vocation de culture. Tous deux forment un couple dépendant du même propriétaire chargé de leur entretien permanent. Ainsi les propriétaires étaient incités à une solidarité pour assurer leur entretien ; celui des accès entre terrasses et ceux des murets communaux étaient l’occasion de corvées.
Faute d’avoir la même importance, les murets sont menacés par manque d’entretien et d’excès de plantes ligneuses. Les murets du GR50 présentent des «brèches» en aval etdes «ventres» en amont. Seule une prise de conscience collective de notre identité peut sauvegarder ce témoin précieux du travail des hommes, en favorisant l’essor des chantiers «pierre sèche».
Pourquoi des terrasses ?
La discordance entre l’importance des terres destinées aux animaux (pâturage et fourrage) et le peu de surfaces disponibles consacrées aux céréales à proximité du village pourraient justifier ces terrasses. Ce rééquilibrage est favorisé par l’orientation sud, la fertilité des sols (d’origine morainique), l’abondance et la qualité des grès pour la construction des murets. Elles facilitent le travail des hommes, luttent contre l’érosion en maitrisant le ravinement, contribuent à la protection des risques naturels. Elles ont permis de subvenir aux besoins d’une population déjà très importante au Moyen Age (environ 1000 habitants). Aujourd’hui ces structures se prêtent mal à l’évolution des moyens de culture modernes mieux adaptés aux zones de plaines, d’où l’obligation de trouver des compromis entre les différents enjeux : agricoles, touristiques, contraintes de biodiversité, protection des risques naturels et respect des legs ancestraux.
La charrue du laboureur, tractée par un cheval, creusait des sillons horizontaux, retournant la terre vers le bas. L’excès de terre, recueilli au bas du champ, était remonté manuellement grâce au «béliart», assemblage de planches soutenues par deux barres, utilisées comme brancard. Cette technique facilitait également le transport des pierres «estruquées» (extraites) du sol de bas en haut du champ afin de faciliter le labour.
Association «Patrimoine en Réallonnais »