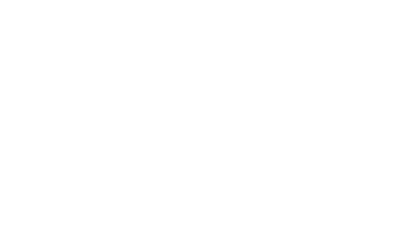Origine du château

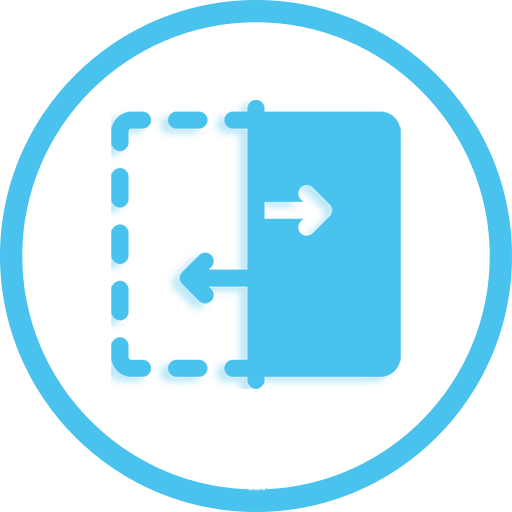



Au XIe siècle, l’Embrunais et plus généralement la région alpine, étaient sous la souveraineté des comtes de Provence. Leur autorité était lointaine et peu contraignante, ce qui permit à quelques grandes familles locales de s’imposer sur une large partie du territoire.
Les Embrun, seigneurs laïcs, étaient à l’époque une famille influente de la ville, et exerçaient un rôle important aux côté de l’archevêque d’Embrun. Mais, en 1080, ils furent chassés de la ville par une révolution municipale fomentée par l’archevêque et dépossédés de leurs charges. Ils se retirèrent alors au centre de leurs propriétés, dans la partie basse de la paroisse de Saint-Jean des Crottes, et y firent construire une tour de bois sur le lieu dit de Picomtal, à l’emplacement actuel du château. Cette tour était un simple observatoire qui permettait de surveiller la vallée en contrebas, s’intégrant ainsi dans le réseau de surveillance organisé par les comtes de Provence et qui, de commune en commune, de Tallard à Briançon, contrôlait la route de la Durance. C’est peut-être là l’origine du nom du château, Podium Comitale en latin, c’est-à-dire le Puy Comtal.
Le château connaît ensuite de nombreuses transformations, en 1270 d’abord, puis vers 1375 et en 1506, avec le souci constant d’en renforcer le rôle militaire. Malgré l’aspect plaisant du château actuel, il s’agit donc avant d’une forteresse parfaitement fonctionnelle de sa création jusqu’au XVIe siècle. Dès le milieu du XIVe siècle, le château dépend d’ailleurs de l’autorité royale qui y entretient une troupe pendant les périodes troubles. Martin de la Villette, seigneur de Picomtal au début du XVIe siècle, est aussi un officier de l’armée royale permanente, et dirige à ce titre une garnison installée au château.
Durant l’été 1692, le duc de Savoie, Victor Amédée II, partie prenante de la Ligue d'Augsbourg contre la France de Louis XIV, pille et détruit une partie de l’actuel territoire haut-alpin. Lors de cette invasion, la population de Picomtal et son seigneur s’enfuirent pour trouver refuge aux Mées en Provence. Déserté par ses habitants, le château fut alors occupé par l’ennemi jusqu’en octobre de la même année.
A la suite de cet épisode, le roi ordonne la construction de la forteresse de Mont-Dauphin, et regroupe les garnisons royales. Picomtal cesse alors d’être un lieu de garnison et perd tout rôle dans la défense de la région.
En 1724, un magistrat, Lazare de Ravel, Conseiller au Parlement d’Aix-en-Provence, racheta Picomtal et ses terres à Elzeard de Guillem, alors propriétaire du château. Pour la première fois dans l’histoire du château, l’acquisition ne se faisait pas par héritage entre seigneurs mais par un achat. Homme raffiné, Lazare de Ravel voulut en faire sa résidence d’été et investit beaucoup d’argent pour y parvenir. Au prix de travaux considérables il modifia les aménagements intérieurs et les abords du château pour en faire une demeure acceptable et digne de son rang de magistrat.
A sa mort, Picomtal et ses terres changèrent de mains à plusieurs reprises. Dans l’ensemble, les successeurs de Lazare de Ravel poursuivirent l’œuvre de mutations entreprise au XVIIIe siècle. C’est ainsi que, constamment habité et entretenu, le château est resté dans un bon état général et sans altération notable de l’apparence extérieure qu’il avait au XVIe siècle.
En 1876, la propriété est vendue aux enchères et acheté par deux sœur Eudoxie et Lydie Amat. Elles agissaient pour le compte du fils de Lydie, Joseph Roman. Ce dernier consacra une partie de sa fortune à la rénovation et à l’embellissement du château. Après sa mort en 1924, le château resta dans la famille Roman d'Amat jusqu'en 1998, date du rachat de l'édifice par Jacques Peureux et Sharon Halperin, qui procédèrent à la dernière restauration de 1999 à 2003.
Le château de Picomtal fut inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1989