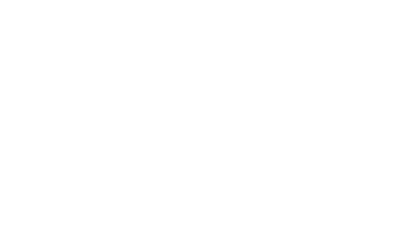Usages et coutumes des fours à pain

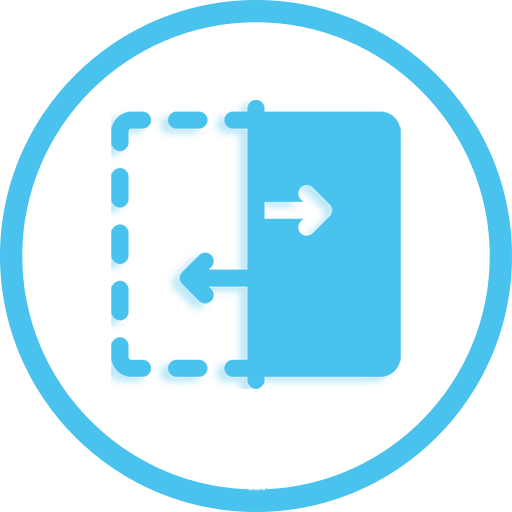



Avec la fontaine, le moulin ou le canal, le four à pain faisait partie des équipements indispensables d’un village. Coûteux à construire, gourmand en bois, mais aussi source potentielle de revenus, le four était généralement mutualisé.
Le seigneur pouvait être propriétaire du four, les habitants lui reversaient alors une redevance appelée le « ban » à chaque utilisation. On parlait alors d’un four banal.
On trouvait également des fours communaux et, du fait de la dispersion de l’habitat, beaucoup de fours appartenant à un village ou un hameau. La communauté d’habitants en définissait collégialement le partage, l’organisation et les droits d’accès.
Lorsque les communautés ont pris de l’importance face au seigneur, les villages et même les hameaux se sont dotés de leur propre four, réservé à leurs habitants. Son usage faisait l’objet d’un règlement collectif.
Les abbayes, des aubergistes, des familles aisées disposaient de leur four particulier. Certains fours privés appartenaient à deux familles.
Dans les villes et les villages très peuplés, la communauté faisait appel à un fournier chargé de gérer le four et de cuire le pain amené par les habitants.
Les boulangers apparaissent à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, lorsque l’arrivée du train et la modernité changent peu à peu les modes de vie.
Dans le cadre d’un usage collectif, cas le plus fréquent, une entente entre villageois était nécessaire, tant pour fournir le bois nécessaire, lancer et contrôler la chauffe, nettoyer le four une fois chaud, organiser puis respecter les tours de cuisson.
La construction du four témoigne toujours d’une intelligence des lieux et des usages. Il est toujours placé sur une voie de passage, souvent au centre du village, près d’une fontaine, voire du lavoir ou d’un ruisseau afin de faciliter le nettoyage de la sole. Il voisine fréquemment avec la chapelle, l’église ou le temple : ce regroupement des installations collectives est le signe d’une véritable vie en communauté.
La cuisson représentait un enjeu considérable car la fournée de l’automne servait à alimenter la communauté en pain pour tout l’hiver.
Le four à pain est ainsi le témoin d’une histoire du pain propre à chaque village. Les nombreuses restaurations et les usages festifs dont les fours à pain font aujourd’hui l’objet montrent combien ils restent essentiels à la vie d’un village.
Hier comme aujourd’hui, le four à pain rassemble!
Texte : Association des Amis de l’Abbaye de Clausonne