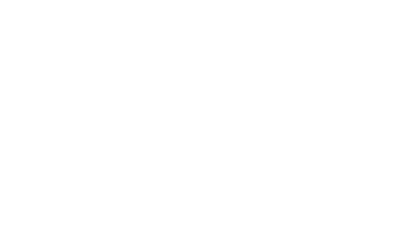Muséographie - 'Les abbés de la période bénédictine'

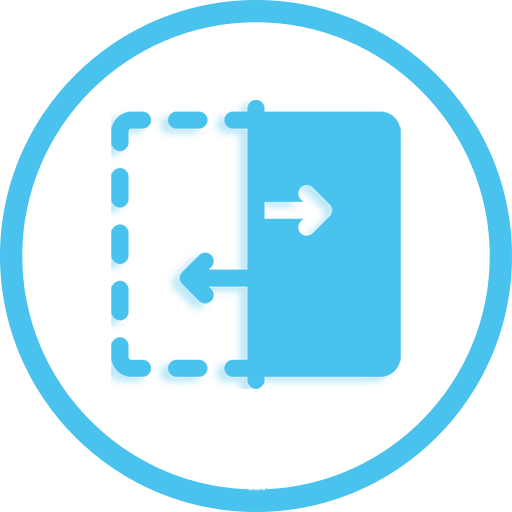



Claude d’Arces
La famille D’Arces
En 1682, dans son ouvrage Les Mazures de l’Abbaye Royale de L’Isle Barbe, Claude Le Laboureur décrit ainsi la famille d’Arces : « Cette famille riche et bien nantie nous a donné plusieurs religieux, dont Claude d’Arces, qui fut abbé de Boscodon ». Ses armoiries sont « d’azur au franc quartier d’or à une bande cotice en devise composée d’argent et de gueule de 7 pièces, brochant sur le tout ». Claude a pour parents Bon d’Arces, seigneur de la Bâtie de Meylan en Dauphiné – propriété familiale depuis deux générations – et Louise Lambert, dame de Lissieu, près d’Anse en Beaujolais et de Condrieux. Né à Grenoble vers 1451, Claude est « doué d’un bel esprit et d’un bon naturel, ses parents l’ayant cultivé par l’étude des belles lettres ». Devenu religieux bénédictin, il obtient son premier bénéfice en tant que cellérier de l’Île Barbe.
Un bon négociateur
En 1474, Claude d’Arces devient abbé de Boscodon. Nommé par une bulle du pape Sixte IV, il est aussi le dernier à être élu par ses pairs, les moines de l’abbaye. Cela lui permet de mener à bien les travaux initiés par ses prédécesseurs : le réaménagement de l’aile des moines et l’édification d’un nouveau cellier au sud ; mais aussi de négocier avec succès le règlement des conflits qui opposent l’abbaye à ses voisins. En 1487, il met un terme aux différends avec l’archevêque et le chapitre d’Embrun, puis règle le problème des droits de pâturage sur la montagne de Morgon, en signant un accord avec les communes de Saint-Sauveur et de Baratier. Il reconnaît enfin en 1497 devoir payer au Dauphin une dîme de quatre setiers d’avoine pour prix de la protection que celui-ci accorde aux convois de radeaux du monastère, qui acheminent les bois de Boscodon vers la Provence ; ils étaient en effet menacés par les gens du coseigneur des Crottes et de Savines, qui en avaient détruit un en 1444.
Un bon gestionnaire
Le nouvel abbé se révèle enfin un bon gestionnaire : en 1492, il crée les cinq offices de prieur, camérier, cellérier, sacristain et chantre. A cet effet, l’ancien cellier et l’aile de convers sont réaménagés, et 5 granges construites à l’ouest.
Il n’en reste plus qu’une aujourd’hui.
Il consolide le commerce du bois en signant des contrats de fourniture, en particulier avec des marchands de Gênes à qui il promet le 4 juin 1501 la vente de 4 douzaines et demi d’arbres pendant 9 ans. Il va même jusqu’à abandonner l’élevage des moutons, revendant les troupeaux et mettant les pâturages en location.
Diverses charges
Claude d’Arces jouit également d’une grande estime dans la région : outre celles de cellérier de l’Île-Barbe et d’abbé de Boscodon, il assume ainsi les charges de grand-prieur de l’abbaye de Saint-Chef (près de Bourgoin en Isère), de prieur de Vizille et de Notre-Dame de Commiers, et de camérier de Saint-Pierre de Vienne. Il semble qu'il ait privilégié Boscodon pour sa résidence.
Lorsqu’en 1510 meurt l’archevêque d’Embrun, Rostaing d’Ancerune, le siège reste vacant. Jean de Médicis, nommé par le pape, se récuse. Les chanoines d’Embrun décident alors d’élire de leur propre autorité Claude d’Arces comme archevêque ; un choix qu’approuve le roi de France. Mais c’est sans compter l’autorité du pape, qui décide de nommer Nicolas de Fiesque ; ce dernier ne vient toutefois pas s’installer à Embrun, et désigne le chanoine de Gap Hugues Livet pour le représenter. Un procès s’engage alors entre les deux compétiteurs. Le roi Louis XII, dont on connaît les ambitions italiennes, craint de s’aliéner la puissante famille génoise des Fiesque, et ordonne d’investir Nicolas de Fiesque, abandonnant de fait son propre candidat. Une bulle de 1513 vient consacrer le fait accompli. Claude d’Arces, contraint et forcé, se retire.
De retour à Boscodon, il continue de s’occuper de son abbaye, et obtient en 1517 du roi François Ier confirmation de ses privilèges. Il meurt le 17 mai 1518 à Boscodon, où il est inhumé « sous les pieds de ses frères », probablement dans un caveau situé près de la porte de la sacristie, vers le cloître. Un morceau de sa pierre tombale nous est parvenu, où figurent notamment ses armoiries.
En 1520, grâce à son œuvre, l’abbaye a retrouvé son effectif de 12 moines et sa place dans l’Embrunais.