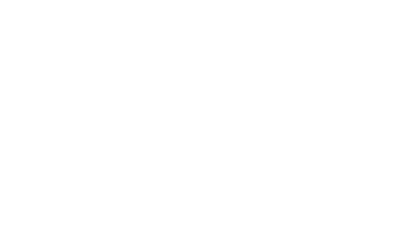Les Fontaines

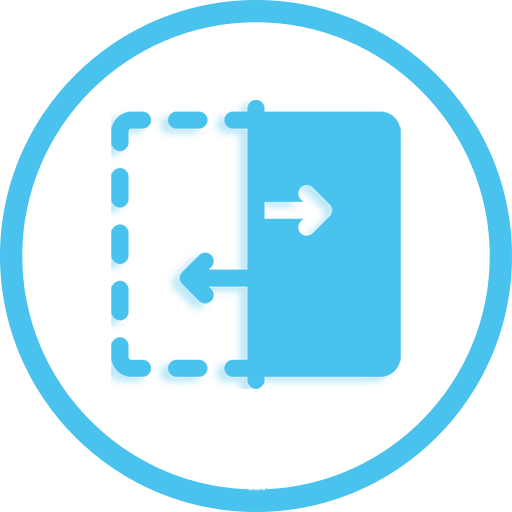



Chaque hameau ou quartier possédait sa propre fontaine, seule source d’approvisionnement en eau potable ; chacun allait y chercher l’eau nécessaire à la vie quotidienne. Les fontaines étaient généralement constituées d’une borne et de deux bassins (bachas ou bacal) en mélèze : d’un abreuvoir pour les bêtes se déversant dans le lavoir où le linge était battu et rincé, la lessive (bua) étant façonnée à la maison.
Compte tenu du fait que les fontaines étaient utilisées par l’ensemble de la communauté, l’entretien des adductions d’eau s’organisait par corvées collectives ou était confié à des spécialistes locaux. Dans la deuxième moitié du XIXe, dans le souci d’assainir les canalisations et d’augmenter les points d’eau, les fontaines se multiplièrent. Les municipalités ne les voulaient plus uniquement fonctionnelles ; elles souhaitaient aussi qu’elles embellissent le bâti et qu’elles reflètent la « richesse » de la communauté. Elles se caractérisent alors par un bassin circulaire en pierre de taille et une borne centrale à quatre canons auxquels s'ajoutent souvent un lavoir en bois et un auvent. L’usage communautaire est resté important jusqu’à l’installation de l’eau courante dans les maisons vers 1930.
Source : https://www.paysdesecrins.com